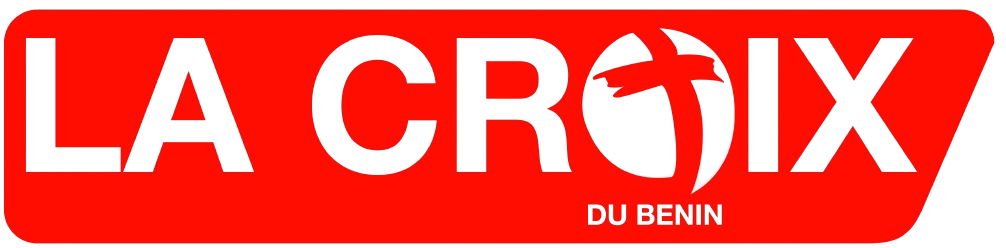AMNISTIE POUR HUNTER BIDEN ET LEVEE DES CHARGES CONTRE DONALD TRUMP
Une décision à double impact
Le 1er décembre 2024, dans les derniers jours de son mandat, Joe Biden, président sortant des États-Unis, a pris deux décisions qui ont agité la scène politique américaine et bien au-delà : accorder une amnistie à son fils, Hunter Biden, en levant les charges criminelles dont il faisait l'objet, et supprimer les accusations fédérales portées contre le président- élu Donald Trump. Ces actions, bien qu'inédites et controversées, posent de nombreuses questions sur l’usage du pouvoir de grâce présidentielle, son rôle dans le système de séparation des pouvoirs et ses répercussions sur l’intégrité de la démocratie américaine.
 Père Nathanaël DAN, Spécialiste en négociations politiques et relations internationales
Père Nathanaël DAN, Spécialiste en négociations politiques et relations internationales
L ’Article II, Section 2 de la Constitution des États-Unis confère au président un pouvoir de grâce vaste et unilatéral, lui permettant d'octroyer des pardons et des sursis pour des infractions fédérales. Cette prérogative, qui exclut les cas de destitution, a été conçue pour servir de filet de sécurité en cas d’erreurs judiciaires, mais aussi comme un moyen de faire preuve de clémence. Une prérogative constitutionnelle Dans le cadre de l’amnistie accordée à Hunter Biden, ce pouvoir a été mobilisé pour éteindre les poursuites liées à des infractions fiscales et la possession illégale d’une arme à feu, ces délits ayant marqué l’année 2024. De même, la décision de lever les charges criminelles pesant sur Donald Trump, notamment en ce qui concerne la rétention de documents classifiés et les accusations d’obstruction à la justice, repose sur le même fondement juridique. Toutefois, cette décision soulève des interrogations sur le respect des principes fondamentaux de la justice. Dans son Federalist Paper n°74, Alexander Hamilton défend l’usage de ce pouvoir en soulignant qu’il permet de tempérer les rigueurs de la justice, offrant ainsi au président un moyen de corriger des erreurs judiciaires. Mais en même temps, il met en garde contre les abus lorsqu’il affirme que « le pouvoir de grâce présidentielle doit être un instrument de justice tempérée par la miséricorde ». Hamilton reconnaît que ce pouvoir peut devenir un outil de manipulation du judiciaire et préconise qu’il soit utilisé de manière parcimonieuse, dans le respect des principes démocratiques. Ce qui est ambigu ici est l’intuition que ces grâces ont été motivées par des considérations partisanes, compromettant ainsi la confiance en l’impartialité du système judiciaire américain. Le fils du président sortant faisait face à des accusations de fraude fiscale et de trafic d’influence, tandis que Donald Trump était impliqué dans plusieurs enquêtes criminelles, notamment pour son rôle présumé dans l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et pour des documents confidentiels mal gérés. En graciant son fils et en levant les charges contre Trump, le président sortant, Joe Biden, a invoqué « la nécessité de tourner la page pour le bien de la Nation». Cependant, la perception publique est loin d’être unanime. Un sondage réalisé par le Pew Research Center révèle que 62% des Américains considèrent cette décision comme une tentative de protection personnelle et familiale, plutôt qu’un acte dans l’intérêt national. L’Etat de droit face à l’érosion de la confiance L’une des pierres angulaires de la démocratie américaine est l’Etat de droit, qui garantit que nul n’est au-dessus des lois. "The Unites States is a country of laws", répète-t-on souvent à Washington, D.C. Toutefois, lorsque des responsables politiques utilisent leurs pouvoirs constitutionnels à des fins personnelles, cela affaiblit la confiance du public dans les institutions. L'un des aspects les plus préoccupants de cette décision est qu’elle remet en cause l’impartialité du système judiciaire. Car lorsque le pouvoir de grâce est perçu comme étant utilisé pour servir des intérêts personnels ou politiques, comme c’est le cas ici avec Hunter Biden et Donald Trump, il sape l'intégrité du système judiciaire et érode la confiance publique. En donnant une grâce à son fils et en levant les charges contre son prédécesseur, le président sortant et les juges semblent enfreindre cette frontière. Ce qui crée un précédent dangereux dans un contexte déjà marqué par une polarisation politique accrue. Or le pouvoir judiciaire dans une démocratie repose en grande partie sur la perception de l’équité des décisions prises. Et dans le cas actuel, il est difficile de ne pas voir l'influence des dynamiques politiques, familiales et partisanes. Le recours à la grâce par des présidents pour protéger des proches ou des alliés politiques est loin d'être inédit, mais dans un contexte où la société américaine est de plus en plus fracturée, cela renforce les préoccupations quant à la transparence du Gouvernement et à la séparation des pouvoirs. La question essentielle ici est de savoir si cette amnistie affaiblit la légitimité du système démocratique. Et la réponse ici est : Oui ! En dégageant ses proches de toute responsabilité judiciaire, le président sortant envoie un signal trouble sur la manière dont le pouvoir peut être utilisé à des fins privées. Or une démocratie se mesure à sa capacité à protéger l’Etat de droit, même face à des leaders politiques puissants. En somme, la double décision du président sortant des Usa, Joe Biden, d’amnistier son fils et de lever les charges contre Donald Trump reflète un moment critique dans l’histoire politique américaine. Elle met en lumière les tensions entre justice, politique et pouvoir dans une démocratie où l’équilibre entre ces forces est essentiel. Si cette décision peut être interprétée comme une tentative pour désamorcer des crises, elle soulève des questions sur l’intégrité des institutions démocratiques et la nécessité de préserver leur impartialité. La démocratie américaine survivra, certes, à cet épisode, mais elle doit tirer les leçons de cette controverse pour renforcer ses fondations et préserver l’idéal d’un gouvernement véritablement guidé par la justice et l’équité.