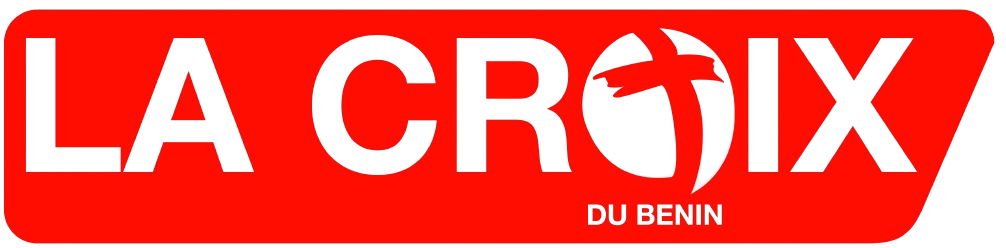RECONNAISSANCE DE L’ETAT PALESTINIEN
« La volonté majoritaire des Etats ne suffit pas »
(Interview du Père Nathanaël Dan, spécialiste en relations internationales)
Depuis deux ans, l’incursion d’un commando du Hamas en Israël qui a causé plusieurs morts et la prise d'otages, a déclenché la foudre de l’Etat hébreu. Ses forces armées ont tué à ce jour plus de 66.000 personnes principalement dans la bande de Gaza. Dans la foulée, la création d'un Etat palestinien revient au-devant de la scène sans qu'on en perçoive très bien les contours. Dans cette interview, le Père Nathanaël Dan, spécialiste en relations internationales, parle des conditions pour une paix durable en Palestine.
 Propos recueillis par Alain SESSOU
Propos recueillis par Alain SESSOU
La Croix du Bénin : Lors de la dernière Assemblée Générale des Nations Unies à New York, près de 160 pays ont adhéré à l’idée de création d’un Etat palestinien. En revanche, certains pays comme les Usa s’y sont opposés. Quelle appréciation faites-vous de cette situation ? Père Nathanaël Dan : Ce soutien massif, inédit depuis la Résolution 181 de 1947 sur le partage de la Palestine, traduit un tournant historique : la cause palestinienne est désormais perçue non plus seulement comme un dossier régional, mais comme un enjeu global de Droit international et de justice. Pourtant, malgré cette quasi-unanimité diplomatique, le processus reste paralysé par le veto américain et l'opposition farouche de l'extrême droite du Gouvernement israélien, révélant une fracture profonde entre la légitimité politique mondiale et la puissance juridique des institutions onusiennes. Sur le plan diplomatique, la reconnaissance par une majorité d’États constitue un acte politique fort : elle crée une réalité symbolique, favorise l’ouverture d’ambassades et permet à la Palestine d’adhérer à certaines Organisations internationales. Depuis 2012, la Palestine dispose du statut d’État observateur non membre à l’Onu, une étape majeure qui lui permet de siéger à la Cour pénale internationale (Cpi) et de saisir la Cour internationale de justice (Cij) en cas de besoin. Ces instruments juridiques renforcent la visibilité du peuple palestinien dans les forums multilatéraux. Cependant, cette reconnaissance demeure dépourvue d’effets coercitifs. Seul le Conseil de Sécurité des Nations Unies détient la capacité de conférer à un État le plein statut de membre de l'Onu. Or, les États-Unis, membre permanent doté du droit de veto, s’opposent depuis des décennies à toute résolution jugée défavorable à Israël. Cette asymétrie institutionnelle fige la situation. Elle illustre un paradoxe du système international : la volonté majoritaire des États ne suffit pas à créer une réalité juridique tant que la puissance des acteurs dominants n’y consent pas. L’histoire regorge de précédents comparables : la reconnaissance du Kosovo, par exemple, a suscité un large consensus occidental, mais sans validation du Conseil de Sécurité en raison du veto russe. Le cas palestinien obéit à la même logique : la souveraineté proclamée ne devient pas souveraineté effective sans contrôle territorial, autonomie institutionnelle et reconnaissance universelle. Ce blocage politique n’est pas sans conséquence sur la stabilité du Moyen-Orient. Il alimente une tension latente entre les pays de la région et provoque une recomposition des alliances diplomatiques. D’une part, la montée des reconnaissances internationales exerce une pression croissante sur Israël. Certains pays européens, en annonçant leur reconnaissance formelle, cherchent à forcer le retour à la table des négociations. Des mesures symboliques - suspension d’accords de coopération ou restrictions économiques ciblées - deviennent des outils de diplomatie coercitive. Néanmoins, ces gestes restent essentiellement politiques et n’entament guère les réalités sécuritaires sur le terrain. D’autre part, cette dynamique fragilise l’unité du monde arabe. Tandis que certains États comme l’Égypte ou la Jordanie privilégient la stabilité régionale et la coordination sécuritaire avec Israël, d’autres - notamment l’Iran, la Turquie ou le Qatar - adoptent une posture plus offensive en soutien aux factions palestiniennes. Le résultat est une fragmentation du front arabe, comparable à celle provoquée par les Accords de Camp David (1978) : la paix entre l’Égypte et Israël a durablement assuré la sécurité des deux pays, mais au prix d’une profonde discorde inter-arabe. Cette tension a également des effets juridiques. Les plaintes déposées devant la Cij ou la Cpipar la Palestine contre certains comportements d'Israël (colonisation, expropriations, opérations militaires) obligent les États de la région à prendre position. Ceux qui soutiennent ces procédures s’exposent à des représailles économiques ou diplomatiques ; ceux qui s’en distancient risquent d’être accusés de trahir la cause palestinienne. Ainsi, le Droit devient une arme diplomatique à double tranchant. Enfin, la situation impacte directement la coopération régionale en matière de sécurité et de l’humanitaire. Les flux de réfugiés, la surveillance des frontières et la gestion des corridors humanitaires (notamment via l’Égypte et la Jordanie) deviennent des leviers de négociation permanente. La reconnaissance de la Palestine, loin d’apaiser la région, ravive donc les fractures et complexifie la gouvernance collective du conflit. Un accord de paix vient d’être signé sous l’égide du président Donald Trump concernant Gaza. Espoir ou mirage ? Dans ce contexte de tensions, la signature d’un Accord de paix relatif à Gaza sous l’égide du président Trump a suscité autant d’espoir que de scepticisme. Pour qu’un tel texte devienne un gage de stabilité durable, plusieurs conditions fondamentales doivent être réunies. La première est la clarté et la vérifiabilité du processus. Tout cessez-le-feu doit s’accompagner d’une séquence précise : retrait progressif des forces, libération des otages, ouverture de couloirs humanitaires et accès des observateurs internationaux. Les Accords d’Oslo (1993-1995) ont échoué en grande partie parce qu’ils manquaient de mécanismes d’évaluation et de sanctions en cas de non-respect. Sans dispositifs concrets, les engagements restent lettre morte. Deuxième condition : la création d’un mécanisme international de surveillance. Les expériences de paix réussies - comme celles du Liban en 1990 ou du Timor-Leste en 1999 - ont toujours reposé sur la présence d’une Force multinationale mandatée par le Conseil de Sécurité, chargée de vérifier l’application des clauses sécuritaires. Une telle structure, sous l’égide de l’Onu ou d’un « Quartet » (États-Unis, Union européenne, Russie, Onu), pourrait garantir la neutralité et la transparence du processus. Troisième exigence : la reconstruction économique de Gaza. La guerre a laissé une enclave exsangue, dépendante de l’aide extérieure. Sans plan de redressement économique encadré par un fonds fiduciaire international (Banque mondiale, Onu, bailleurs arabes), la misère alimente fatalement les extrémismes. Or, toute aide doit être conditionnée à la transparence et à la démilitarisation effective du territoire, afin d’éviter la captation des fonds par des groupes armés. Quatrième condition : la démilitarisation progressive mais vérifiable de la bande de Gaza. La sécurité d’Israël et la stabilité des voisins exigent la fin de la prolifération des armes. Cependant, la démilitarisation ne peut être imposée sans contrepartie politique. Il faut offrir aux Palestiniens un horizon institutionnel crédible: des élections libres, une représentation unifiée et la perspective tangible d’un État viable. Sans cela, toute trêve demeurera précaire. Enfin, le succès d’un tel Accord dépend du soutien des puissances régionales. Les voisins immédiats (Égypte, Jordanie) et les acteurs majeurs du Golfe doivent s’engager à garantir les frontières, à contrôler les flux d’armes et à financer la reconstruction. Les traités de paix durable, comme celui d’Égypte-Israël, n’ont fonctionné qu’à condition d’être adossés à des garanties économiques et militaires tangibles. Pour donner à l’Accord une valeur juridique solide, il serait souhaitable qu’il soit formellement approuvé par une résolution du Conseil de Sécurité. Cela permettrait d’en faire un instrument contraignant du Droit international, assorti d’un mécanisme de reddition de comptes en cas de violation. Au regard de tout ce que vous venez de dire, comment sortir de l’impasse ? La situation actuelle illustre une crise de l’architecture multilatérale. D’un côté, la communauté internationale affirme à 80% sa volonté de reconnaître la Palestine; de l’autre, la structure décisionnelle des Nations Unies empêche la concrétisation de cette volonté. Le Droit, ici, se heurte à la géopolitique. Pour sortir de cette impasse, deux voies doivent être combinées: juridiquement, il faut donner aux résolutions onusiennes un caractère exécutoire en y associant des mécanismes de contrôle ; politiquement, il faut rétablir la confiance par un équilibre des garanties : sécurité d’Israël, dignité et autonomie des Palestiniens. L’histoire diplomatique récente montre que les Accords de paix qui réussissent - de Camp David à Dayton - reposent sur la rencontre entre légitimité politique, garanties juridiques et intérêts sécuritaires partagés. Tant que ces trois piliers ne seront pas réunis, la reconnaissance de l’État palestinien restera un horizon moral et symbolique, mais non une réalité souveraine.